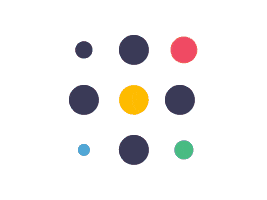
Choisissez vos cookies 🍪
Nous utilisons des cookies, car ils sont essentiels pour vous offrir une qualité de navigation optimale et personnalisée, mesurer l'audience de notre site et vous proposer un contenu toujours plus en adéquation avec vos attentes. Mais c’est vous qui gardez le contrôle sur les données que nous collectons et utilisons, bien sûr. En cliquant sur "Accepter", vous acceptez le dépôt de cookies et leur utilisation dans les conditions prévues par notre Politique relative aux cookies.Vous pourrez par la suite modifier vos préférences cookies à tout moment en cliquant sur "Gérer mes cookies" en bas de page.
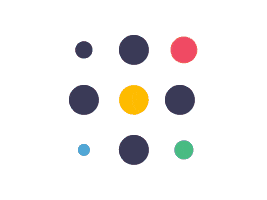
Fermer
Lexique commercial
Notre petit lexique des mots barbares à l'usage des (non)initiés
A
Dans une vente immobilière (logement, terrain, murs commerciaux), l’acte authentique est le contrat définitif de cession signé chez un officier public (généralement un notaire) et non chez un avocat. L’acte authentique, en constatant la vente définitive, garantit la date de signature et le contenu du contrat avec ses différentes conditions. Il s’agit donc d’un élément de preuve incontestable en cas de litige.
Si un exploitant souhaite céder son affaire et qu'il est soumis à un bail commercial, ce dernier stipule au chapitre “cession” les modalités de vente : acte authentique (avec donc l’intervention d’un notaire) ou sous seing privé (soit directement entre cédant et repreneur - ce qui est vivement déconseillé - ou avec l’intervention d’un avocat).
L'acte de vente définitif est un contrat officiel signé devant l’avocat ou le notaire : il conclut et clôture le processus de vente du bien entre le vendeur et l'acheteur. L'acte de vente définitif ou acte authentique de vente d'un bien intervient quelques semaines ou mois (en moyenne 3 mois) après l'offre d'achat, cette dernière ayant ensuite abouti à la signature d’un compromis de vente (ou promesse de vente).
Une période d’environ 2 mois (rarement moins) sépare la signature du compromis de vente et celle de l’acte définitif, afin de permettre aux parties de lever les différentes conditions suspensives, dont souvent l’obtention d’un prêt bancaire.
L'acte de vente définitif se concrétise par le paiement du prix de vente du bien par l'acquéreur et par la remise à celui-ci des clés de l'affaire et des moyens de paiement (chéquier, cartes de crédit) par le vendeur.
Élément du patrimoine d’une entreprise ayant une valeur positive déterminée. L'actif au sens large désigne en l'ensemble du patrimoine de l'entreprise, soit tout ce qu'elle possède. L’actif constitue la première partie (ou partie gauche) du bilan comptable, que l’on met en parallèle avec le passif (emplois des ressources) qui constitue le passif (seconde partie ou partie droite du bilan).
L'actif est constitué d’abord par l’actif immobilisé (aussi appelé "immobilisations"), décliné en immobilisations incorporelles (comme le fonds de commerce), immobilisations corporelles (comme le matériel et les agencements) et immobilisations financières (comme les cautions ou les titres de participation), puis par l’actif circulant, décliné en stocks (marchandises), créances (les factures encore non-encaissées) et disponibilités (trésorerie).
Lorsqu’une entreprise acquiert du matériel, des équipements, des véhicules, des bâtiments, ou qu’elle réalise des travaux, tous ces éléments intègrent son actif. N’y sont pas inclus les éléments utilisés dans le cadre d’une location financière (leasing véhicule par exemple), dont les loyers sont comptabilisés en charges externes.
L’usure et l’obsolescence de ces éléments sont exprimées en durée selon des normes comptables précises.
La valeur de chaque élément est segmentée en années (de 3 à 25 ans, jusqu’à 50 ans pour certains bâtiments), le total des amortissements de l’année (exercice comptable) venant en déduction du bénéfice imposable. La charge financière de chaque élément est donc comptablement étalée dans le temps.
Cette dotation aux amortissements permet à l’entreprise de prévoir le remplacement des biens concernés, puisque si c’est une charge comptable, elle n’est pas concrètement décaissée.
B
Le bail commercial est un contrat de location d'un local destiné à une activité commerciale, industrielle ou artisanale. C’est un engagement de longue durée, cette dernière étant variable en fonction de la nature du bail (généralement 9 ans, voire 10 ou 12). Le local doit servir à l'exploitation d'un fonds de commerce.
Le contrat de bail définit les obligations réciproques du propriétaire du local (bailleur) et du locataire (preneur). La fixation du loyer est libre, mais sa révision est légalement encadrée. Le contrat de bail commercial protège le locataire, car en fin de bail celui-ci bénéficie d'un renouvellement du bail ou d'une indemnité d'éviction.
Il existe différents types et durées de bail commercial, tous comprenant des éléments primordiaux que le preneur doit soigneusement examiner avant la signature du contrat.
Le bail de courte durée, aussi appelé bail dérogatoire ou plus communément bail précaire, bénéficie du régime dérogatoire au bail commercial. Sa durée maximale est de 3 ans. S'il est possible de conclure plusieurs baux de courte durée successifs avec le même locataire dans les mêmes locaux, la durée totale de ces baux ne doit pas dépasser 3 ans. Si le locataire reste dans les lieux après cette durée, le bail devient un bail commercial classique.
Les bénéfices industriels et commerciaux (BIC) sont les bénéfices réalisés par les personnes physiques exerçant une activité commerciale (ou industrielle, ou artisanale). Les BIC entrent dans le revenu imposable en fonction du régime fiscal (micro BIC, réel simplifié ou réel normal).
Synthèse de fin d’exercice comptable, qui fait état de ce que l'entreprise possède (l'actif comme le fonds de commerce, les terrains, immeubles, le matériel) et de ses ressources (le passif comme le capital, les réserves, crédits bancaires, dettes diverses).
Le bilan est clôturé tous les 12 mois (généralement en fin d’année civile, soit au 31 décembre). Si l’exercice n’a duré que quelques mois (suite à la reprise d’un fonds de commerce en cours d’année par exemple), l’on peut alors “consolider” le bilan en additionnant ces quelques mois avec l’année civile complète suivante.
Le bilan est une « photographie » du patrimoine de l'entreprise à un instant T, qui permet de réaliser une évaluation d'entreprise, et indispensable aux partenaires et autres (banques, administrations, franchiseurs, notamment) pour contrôler la solvabilité de l'entreprise (pour accorder une ligne de découvert, par exemple, et bien entendu pour évaluer les impôts, taxes et redevances).
Les bénéfices non commerciaux (BNC) concernent les personnes exerçant une activité professionnelle non commerciale (à titre individuel ou en tant qu'associé). Ils sont soumis à l'impôt sur le revenu. Le bénéfice de l'entreprise individuelle se confond avec la rémunération du professionnel. Les BNC entrent dans le revenu imposable selon le régime fiscal (micro BNC ou normal).
Locaux hébergeant des salariés, fonctionnaires ou indépendants travaillant pour des entreprises, organisations, administrations ou associations. Il s’agit la plupart du temps d’activités du secteur tertiaire. Ils peuvent également faire partie d’un immeuble, d'entrepôts, de murs de magasins, d’usines, etc.
Projections d'évolution d'une entreprise ou d’un commerce, détaillant les futures sources de chiffre d’affaires, les coûts de mise en œuvre, les charges de fonctionnement, les méthodes de déploiement et les délais dans lesquels les objectifs sont susceptibles d’être atteints.
Le business plan décrit également la structuration et l’organisation de l’entreprise, notamment en ressources humaines, ainsi que la communication et le marketing utilisés.
Il intègre un plan de financement qui détaille les besoins et les ressources. Ce document sert de feuille de route à l’entrepreneur, mais est également nécessaire afin d’obtenir un prêt bancaire ou tout autre type de financement.
C
La caisse autonome des règlements pécuniaires des avocats, ou CARPA, est un organisme de sécurisation des maniements de fonds opérés par les avocats pour le compte de leurs clients. L’un de ses objectifs est notamment la lutte contre le blanchiment d'argent.
Le compte CARPA est un “filtre” obligatoire sur lequel doivent transiter les sommes reçues par l'avocat, déposées sur un sous-compte pour l’affaire concerné par l’opération de cession/acquisition. Le séquestre désigné dans l’opération (l’avocat ou l’un des deux avocats des parties) utilise ce compte pour payer les divers créanciers qui se manifestent après la signature de l’acte définitif.
Opération juridique par laquelle la propriété d'un bien passe du patrimoine du vendeur (généralement appelé cédant) à celui de l’acquéreur (généralement appelé cessionnaire). La cession d’un fonds de commerce ou de parts sociales est la vente d'un ensemble de biens mobiliers (marchandises, matériel, équipements) et de droits (enseigne, nom commercial, droit au bail, clientèle).
Partie du compte de résultat détaillé (lui-même partie du bilan) listant les charges et dépenses engagées par une entreprise durant l’exercice comptable, et présentées dans un ordre précis de comptes numérotés suivant le plan comptable.
Les charges externes sont désignées comme variables (comme les consommations d’eau ou d’électricité, proportionnelles à l’activité de l’entreprise) ou fixes (comme le loyer, dont le montant ne dépend pas du niveau d’activité de l’entreprise).
Les charges externes n’intègrent pas les salaires, impôts ou coûts marchandises et matières premières. La maîtrise des charges externes est un élément primordial en gestion d’entreprise.
Total des ventes de biens ou de services d'une entreprise sur la durée d’un exercice comptable (généralement une année civile). Il peut être constitué par des ventes de marchandises soumises à des coûts d’achat de ces marchandises, et/ou par des commissions nettes (productions de service), honoraires, etc.
C’est l’un des facteurs entrant en ligne de compte dans l’évaluation d’un fonds de commerce. Dans ce cas l’on retient le montant du chiffres d’affaires hors taxe, du fait que l’exploitant n’est que collecteur de la TVA, celle-ci ne pouvant donc constituer un élément de valorisation.
Anglicisme désignant l’étape finale du processus de cession. Il correspond à la signature de l’acte définitif de vente et au paiement du prix de cession par le repreneur. Il intervient généralement quelques mois après la signature du protocole d’accord (compromis de vente sous conditions suspensives), lorsque toutes les conditions suspensives sont levées.
Contrat par lequel une personne (physique ou morale) s'engage à vendre un bien à une autre personne (physique ou morale), qui s'engage à son tour à l'acheter sous certaines conditions, avec des obligations réciproques. Le compromis de vente prévoit un délai pour régulariser l'acte de cession définitif. En matière de cession de fonds de commerce, le compromis de vente (appelé protocole d'accord pour la cession de titres de société) prévoit différentes conditions suspensives.
Ce document est engageant pour les parties, qui contrairement à l’immobilier traditionnel, ne disposent d’aucun délai de rétractation. Cet engagement est notamment matérialisé par le versement d’un dépôt de garantie (usuellement 5 à 10% du prix de cession) par l’acquéreur.
A la fin du délai fixé par le compromis pour procéder à la réitération de l’acte (signature de l’acte de cession), si toutes les conditions suspensives ont été levées et que l’une des parties ne souhaite plus signer l’acte définitif, elle est redevable à l’autre partie d’un montant équivalent au dépôt de garantie, qui aura entre-temps été conservé par le rédacteur des actes.
Intégré au business plan, il est construit sur le modèle d’un compte de résultat classique et permet d’anticiper l’exploitation de l’entreprise dans le futur (il est généralement bâti sur 3 ans) en détaillant les produits et charges connus et prévus par l’exploitant. Il permet ainsi de prévoir le résultat, la rémunération du dirigeant, mais aussi l’imposition et de manière plus générale la fiscalité.
Contrairement au bilan comptable, dont il fait partie, le compte de résultat ne fait pas état des actifs et ressources de l'entreprise, mais se concentre sur l’activité réalisée au cours de l’exercice comptable. Il liste ainsi l'ensemble des produits et des charges, et indique au final le résultat net, soit la variation entre ce que l'entreprise a encaissé et payé.
Le compte de résultat suit la structure du plan comptable, classant les comptes de produits et charges par numéro croissant.
Si le compte de résultat détaille les performance de l’entreprise, il ne mesure toutefois pas le montant d'argent que l'entreprise détient sur ses comptes bancaires (c’est le rôle du plan de trésorerie). C’est par l’établissement du résultat qu’est calculée l’imposition de l’entreprise, ainsi que les dividendes que celle-ci peut verser aux associés et actionnaires.
Le résultat net, qui est un bénéfice ou une perte, fait partie des capitaux propres. De ce fait, il est reporté dans le haut du passif au bilan comptable.
En matière de cession de fonds de commerce, titres de société ou murs commerciaux, c'est une condition inscrite dans le compromis de vente (ou protocole d'accord), qui doit être remplie (levée) avant une date déterminée (au plus tard le jour de la signature de l'acte définitif), afin que la cession puisse avoir effectivement lieu.
La non-réalisation d'une condition suspensive entraîne l'annulation de la transaction, son report ou l'ouverture à la renégociation de certains termes, en fonction de la manière dont la condition est libellée.
Il y a généralement plusieurs conditions suspensives inscrites dans un compromis de vente, les plus classiques étant l'obtention d'un financement pour l'acquéreur, l'agrément du bailleur à la cession, la non-préemption de la commune sur le local visé et la production d'une note d'urbanisme visant à alerter le repreneur sur de potentiels projets urbains susceptibles de modifier ses locaux d'activité dans le futur.
Il est en théorie possible d'inscrire tout type de condition suspensive dans un compromis de vente, si elle est acceptée par les parties et non-contraire à la législation en vigueur. Il est toutefois judicieux de les limiter, en purgeant les problématiques en amont, afin d'optimiser les chances de réussite de la transaction, puisque chaque condition suspensive constitue un obstacle potentiel à l'aboutissement de celle-ci.
Prêt accordé directement par le vendeur à l’acheteur d’un bien, sans le concours d’un établissement bancaire ou d’un partenaire financier.
Il est utilisé notamment sur tout ou partie de l’acquisition d’un fonds de commerce ou de titres de société (souvent par nécessité en complément d’un crédit bancaire classique insuffisant du fait d’un apport nul ou limité).
Il constitue souvent une solution ultime ou obligatoire pour la reprise de stocks importants dans la phase d’acquisition d’une affaire (il arrive que le montant du stock dépasse le montant du prix du fonds).
Le crédit vendeur doit être officialisé par un acte juridique qui en spécifie la durée, le montant du prêt, le taux d’intérêt et les frais annexes. C’est un prêt à court terme d'une durée de 1 à 3 ans.
D
Élément du fonds de commerce qui appartient au locataire en place. La cession du droit au bail est la vente par un commerçant à un autre commerçant du simple droit de lui succéder dans le local qu'il occupe.
Dans le cas d'un changement de destination (changement de l’activité exercée dans le local concerné), la vente du droit au bail est soumise à l'accord préalable du bailleur si cette nouvelle activité n'est pas prévue au contrat de bail en cours. Lors de cette transaction, les parties négocient généralement un nouveau bail à des conditions différentes, notamment tarifaires, mais aussi en terme d’obligations réciproques.
E
L’EBE est un indicateur précieux pour traduire la performance de l’entreprise. Il mesure la rentabilité réelle dégagée durant l’exercice comptable.
Il est obtenu à partir du chiffre d'affaires, dont on soustrait les charges suivantes : marchandises, charges externes, salaires, cotisations sociales et impôts (hors impôts société). Son calcul s'arrête avant la prise en compte des dotations aux amortissements, transferts de charges, produits et charges exceptionnels, charges financières et impôt société.
On trouve l'EBE dans les soldes intermédiaires de gestion, qui constituent l'un des éléments du bilan comptable, au même titre que le compte de résultat. Cependant, bien que leur structure soit assez proche de celle du compte de résultat, les soldes intermédiaires de gestion se concentrent sur les grandes masses de produits et coûts.
Aux normes internationales l’EBE est appelé EBITDA (earnings before interest, taxes, depreciation, and amortization).
L'EBE retraité est calculé à partir de l’EBE (valeur présente dans les soldes intermédiaires de gestion), dont on expurge :
. Les charges d’exploitation exceptionnelles / ponctuelles / non-récurrentes
. Les charges d’exploitation non-indispensables au bon fonctionnement et à la pérennité du chiffre d’affaires et de l’exploitation
. Tout ou partie de la rémunération du ou des dirigeants
L’EBE retraité est obtenu par une analyse au cas-par-cas de chaque exploitation et doit faire l'objet d'un calcul cohérent.
Contrat écrit entre deux parties, visant à préserver la confidentialité des informations communiquées. L'accord fonctionne soit dans un sens, soit dans les deux sens. Ce contrat est utilisé la plupart du temps entre (futurs) partenaires commerciaux, mais aussi avant toute négociation lors de cessions d’entreprises.
Dans cette situation, il permet au repreneur potentiel et à ses conseils divers d’obtenir les éléments confidentiels relatifs à l’entreprise visée (comptabilité, juridique, contrats, accords commerciaux, etc.) en vue de s’assurer de l’état de gestion actuel, passé, mais aussi de valider le prix de vente, qui a fait ou fera l'objet d’une offre d’achat (ou une lettre d'intention) à l’attention du cédant.
A ne pas confondre avec le nom commercial, l'enseigne commerciale est l'appellation du point de vente (le local commercial) et le support physique permettant son identification par les clients. C’est la dénomination sous laquelle le commerce est exercé et connu du public, que le commerçant appose sur sa vitrine (et autres supports).
L'enseigne commerciale peut être constituée par le nom de l'entreprise, le nom de l'exploitant, ou tout autre terme ou simple emblème (logo, objet, signe ou autre symbole). L’enseigne est l’un des éléments incorporels du fonds de commerce. Elle est le prolongement du nom commercial.
Une entreprise est un ensemble de moyens devant opter pour une forme juridique (Sarl, etc.) pour avoir une existence juridique. Elle doit être enregistrée auprès du registre du commerce et des sociétés (RCS), du répertoire des métiers pour les entreprises artisanales, de l’URSSAF pour les professions libérales.
Elle possède une identification unique par son inscription au répertoire SIREN/SIRET. Pour une société, l’enregistrement lui donne la personnalité morale et un statut juridique (sa forme est déterminée par l'objet social, la quantité d’apporteurs de capitaux et leur montant, et le cadre législatif).
L’on distingue les sociétés avec plusieurs associés (société anonyme - SA, société par actions simplifiée - SAS, société à responsabilité limitée - SARL, société civile professionnelle - SCP) et les structures individuelles avec un associé unique ou personne seule (auto-entrepreneur, profession libérale, artisan, entreprise individuelle, EURL), mais aussi les associations ou coopératives (à but non-lucratif).
Détermination de la valeur d’un bien en tenant compte des facteurs spécifiques à son activité et à son marché.
L'estimation et le prix de vente sont souvent différents. La première constitue une solide base de réflexion, le second concrétise l'accord tarifaire trouvé entre un cédant et un repreneur à l'issue des négociations.
Notre estimation de votre affaire est réalisée sur mesure. Elle intègre toutes les facettes de l'exploitation dans une vision opérationnelle globale, en tenant compte de nombreux facteurs comptables et non-comptables.
Etude destinée à analyser les acteurs, forces, faiblesses, besoins et demandes, offres et services, tenants et aboutissants d’un marché donné, quel qu’il soit. Cette étude est réalisée sur différentes facettes, notamment économique, sociologique, géographique, etc.
Dans le domaine de l’entreprise et du commerce, cela passe par l’étude de la concurrence (offre, prix, quantité, emplacement) grâce aux données disponibles sur internet et par la reconnaissance physique, ainsi que l’identification du manque et du besoin au travers de sondages réalisés sur un échantillon de population ou clientèle potentielle.
Période donnée durant laquelle une entreprise enregistre toutes ses activités économiques, en vue d’établir son bilan comptable (dont le compte de résultat et ses annexes) à la clôture de cette période.
La durée d'un exercice est de douze mois (le plus souvent du 1er janvier au 31 décembre de chaque année, bien que cela ne soit pas une obligation) et concerne les entités susceptibles de générer des bénéfices industriels et commerciaux et les professions libérales.
Il est fréquent que, suite à la reprise d’une entreprise ou d’un fonds de commerce en cours d'année civile, l’exercice comptable de la structure acquéreur soit plus court, ou qu’il soit étendu à la totalité de l’année suivante complète (c’est alors un exercice consolidé). La durée maximum est de 24 mois.
F
Description précise et concrète d’un poste au sein de l’entreprise, la fiche de poste sert à définir ou affiner les besoins de celle-ci et organiser sa structure en ressources humaines, en listant les missions et responsabilités de chaque membre de l’organigramme. La fiche de poste sert également à déterminer le profil des candidats éventuels et leur détailler lors d’un recrutement ce qui est attendu d’eux s’ils sont retenus.
La fiche de poste doit idéalement comprendre le descriptif du poste (intitulé du poste, fiche de fonction métier, missions principales, activités et tâches, moyens, conditions et lieu de travail) et le profil du poste (compétences, expérience professionnelle, formation et diplômes).
Le fonds de commerce désigne l’activité en cours d'un commerce ou d'une entreprise, intégrant divers éléments complémentaires et souvent indissociables, dont le droit au bail.
Juridiquement, le fonds de commerce est un ensemble constitué par :
. Les éléments corporels ("palpables") comme les agencements, les installations et aménagements, le mobilier, le matériel et outillage
. Les éléments incorporels (“impalpables”) comme la clientèle, l'achalandage, le droit au bail, le nom commercial, l'enseigne, les licences de restaurant ou débit de boissons, les marques, brevets, dessins et modèles attachés au fonds
Dans le domaine de la cession / acquisition, la reprise d’un fonds de commerce exclut la reprise de la structure juridique de la société exploitant le fonds. l’actif (trésorerie notamment) et le passif (dettes) de la société cédante sont donc conservés par le vendeur.
Dans la vie de l'entreprise, les dépenses engendrées par l'activité précèdent généralement les recettes issues des ventes.
C’est pourquoi il existe la notion de fonds de roulement et de besoin en fonds de roulement, qui est une réserve financière récurrente (cyclique), permettant de couvrir les achats de marchandises et matières premières, les charges, les salaires et les investissements à venir, dont le décaissement est antérieur aux encaissements prévus via le chiffre d’affaires à venir.
Ce décalage doit donc être anticipé par le fonds de roulement, issu soit du chiffre d’affaires déjà réalisé, soit d’une mise de fonds des actionnaires. En matière de création et reprise de fonds de commerce, on chiffre un besoin en fonds de roulement (BFR), qui est la trésorerie de démarrage permettant le fonctionnement immédiat de l’activité (pour disposer d’un fonds de caisse, régler les premières marchandises, le premier loyer, etc.).
Le BFR est déterminé au cas par cas et, s’il ne doit pas être trop réduit (cela peut asphyxier l’activité), il ne doit pas être trop important non plus s’il fait partie des éléments financés par la banque, car dans ce cas il contribue à générer des charges financières au travers des intérêts.
Accord commercial et juridique par lequel une entreprise appelée « franchiseur » s'engage à fournir à une seconde entreprise, dite « franchisée », une marque, un savoir-faire et une assistance continue en contrepartie d'une rémunération (redevance ou royalties). Le terme « franchise » ne s'applique que si les trois conditions précédentes sont réunies.
H
En matière de transaction de fonds de commerce, droit au bail ou parts sociales, l’opération est généralement encadrée juridiquement par un notaire ou un avocat. Les honoraires juridiques sont les émoluments correspondant à sa mission, qui peut également intégrer la constitution de la société et la rédaction des statuts. C’est généralement lui qui s’occupe des différentes formalités auprès du greffe du tribunal de commerce et répercute leur coût à la partie concernée.
I
Ensemble des biens immobiliers détenus par des acteurs professionnels qui n’en sont pas les occupants, et qui en retirent un revenu de manière régulière.
Désigne le marché immobilier relatif à l'achat, la vente et la location de biens immobiliers d'entreprise tels que des locaux commerciaux, terrains, bureaux, entrepôts, parking privatifs, etc.
L
Local utilisé pour exercer une activité commerciale (à la différence d’habitation ou autre). Il peut être utilisé pour vendre, stocker ou fabriquer des biens, ainsi que pour fournir des services. Un local commercial peut être vendu ou loué "brut de béton", signifiant que l'installation de l’activité nécessite des travaux pour le rendre utilisable (électricité, plomberie, lumières, portes, peinture, etc.). Le règlement de la copropriété (s’il y en a une) dans laquelle se trouve le local commercial stipule les activités autorisées ou interdites.
M
La marge commerciale est la différence entre le prix de vente et le prix d'achat de marchandises. La marge est exprimée en euros. Elle est aussi abordée en taux de marge (le rapport de la marge commerciale au chiffre d'affaires HT), qui se calcule ainsi :
Taux de marge commerciale = marge commerciale ÷ ventes de marchandises HT.
La marge brute est la différence entre le prix de vente et le coût de revient total des biens ET services vendus. Il convient donc, afin de définir des marges cohérentes, de mettre en parallèle les coûts d’achat avec leur chiffre d'affaires inhérent.
Les murs commerciaux sont le ou les bâtiments destinés à un usage commercial (bureaux, boutiques, locaux d’activité, etc.). Les murs sont le local commercial dans lequel est exploité un fonds de commerce. L'exploitant peut être locataire ou propriétaire des murs.
N
Nom de l’entreprise qui identifie le fonds de commerce ou l’activité de la société. Il sert aussi à l’immatriculation de l’entreprise. Il figure sur les documents commerciaux, cartes de visite, papier à en-tête de la société ou les factures en plus des mentions obligatoires. Le nom commercial peut être le même que la dénomination sociale, être enregistré au RCS (Registre national du Commerce et des Sociétés) et être cédé puisqu’il désigne l’entreprise.
P
Le pas-de-porte constitue un droit d’entrée dans le local commercial, c'est-à-dire une somme forfaitaire sur laquelle s’entendent le bailleur et le candidat locataire, en plus du loyer mensuel prévu et du dépôt de garantie. Cette somme est versée au propriétaire des murs lors de la conclusion (signature) du bail pour son local vacant et lui est définitivement acquise.
Il s'agit dans ce cas d'une clause du bail. Le pas-de-porte peut aussi être considéré comme un supplément de loyer (cas le plus fréquent), en tant que contrepartie financière à la dépréciation de la valeur vénale des locaux et à la propriété commerciale acquise au locataire (droit au renouvellement du bail), ou en tant que "contrepartie pécuniaire d'éléments de natures diverses, notamment d'avantages commerciaux fournis par le bailleur sans rapport avec le loyer". Le pas-de-porte peut aussi être mixte (supplément de loyer et indemnité).
La notion de droit d'entrée peut aussi concerner, dans un autre registre, la redevance initiale demandée par une enseigne (franchise) lors de la signature du contrat avec le futur franchisé, officialisant l'entrée de celui-ci dans le réseau.
Ce droit d'entrée englobe notamment la formation, le savoir-faire, l'assistance à l'installation, et se voit complété, une fois le point de vente ouvert, par le versement annuel, trimestriel ou mensuel de redevances (royalties), soit forfaitaires, soit (plus généralement) indexées sur le chiffre d'affaires réalisé par le point de vente.
Élément du patrimoine d’une entreprise ayant une valeur négative déterminée. C'est une obligation de l’entreprise envers un tiers. Le passif détaille ce que doit l'entreprise et se décompose en deux grandes catégories :
1. Les capitaux propres, ressource stable pour l'entreprise. Ils sont composés du capital social (les apports des actionnaires), des réserves (part non distribuée des bénéfices des exercices précédents), et du résultat net (issu du compte de résultat), qui peut être un bénéfice ou une perte.
2. Les dettes. On y trouve les comptes courants d’associés, les emprunts bancaires, les dettes envers les fournisseurs, le personnel, le fisc, les organismes sociaux, etc.
R
Contrairement au nom commercial (activité) et à l’enseigne commerciale (local et supports) la dénomination sociale est le nom de l’entreprise. Elle l’identifie donc en tant que personne morale. Elle est déterminée lors de l’immatriculation de l’entreprise au RCS (Registre national du Commerce et des Sociétés). C’est elle qui protège l’entreprise en cas de concurrence déloyale.
La dénomination sociale d’une société peut être constituée de tout terme librement choisi par les associés (en rapport ou non avec l'activité de l'entreprise). Elle est utilisée dans tous les types de sociétés : SARL, EURL, SA, SAS, SNC, etc. Concernant les professions libérales exercées en entreprise individuelle le nom de l'entreprise est celui de son propriétaire.
Ratio qui mesure le rapport entre le résultat net et le total des actifs nets d’une entreprise. Cela permet de vérifier si la rentabilité d’une société est suffisante par rapport à ses ressources.
Formule de calcul : ROA = résultats nets / total des actifs nets
Ratio financier qui mesure la rentabilité des investissements réalisés par une entreprise. Cela permet d'évaluer la qualité des choix d'investissements réalisés avec les capitaux utilisés.
Formule de calcul : ROCE = résultat d'exploitation / (fonds propres + dettes)
Mesure en pourcentage du rapport entre le résultat net et les capitaux propres investis par les associés ou actionnaires de la société.
Formule de calcul : ROE = bénéfice net / moyenne des fonds propres
Ensemble des salariés appartenant à l'entreprise et nécessaires à son bon fonctionnement. L’on peut y inclure le (ou les) dirigeant(s) qui prend part à l’exploitation opérationnelle au quotidien. Les RH se détaillent en poste occupé, détail des tâches accomplies, durée du travail, rémunération mensuelle et annuelle nette et brute et type de contrat. Pour calculer le poids de la masse salariale il convient également d’y ajouter les charges sociales et cotisations patronales.
Espace d'aménagement du territoire pour différentes activités commerciales, et équipé en infrastructures adaptées. Un parc d'activité commerciale est un ensemble commercial à ciel ouvert, réalisé et géré comme une seule unité. Il comprend au moins 5 unités locatives et sa surface est supérieure à 3.000 m² de surface construite.
Mesure en pourcentage du gain attendu sur un investissement par rapport à sa mise de départ. La durée de rentabilité est le temps nécessaire pour que la mise de départ soit récupérée (retour sur investissement égal à zéro).
Formule de calcul : (gains – coûts de l’investissement) / coûts de l’investissement.
Analyse d’une charge (ou d’un produit) comptable en vue de la déduire d’un calcul en tout ou partie si elle est considérée comme exceptionnelle, inutile ou disproportionnée pour assurer la bonne marche de l’exploitation. Adjectif : “retraitable”.
Selon la forme juridique choisie pour sa société le dirigeant peut se rémunérer de diverses manières. Gérant de SARL, il peut recevoir une rémunération au titre de son mandat social ou de son contrat de travail. Président ou directeur de SAS il peut être salarié. Il peut aussi percevoir des dividendes en fonction du résultat de l’exercice ou des primes.
Enfin, il peut compléter sa rémunération avec divers avantages en nature (véhicule, téléphone, blanchisserie, frais de déplacement, missions, etc.). Dans le calcul de l’EBE retraité il convient donc d’en identifier la totalité, ainsi que ses charges sociales et cotisations diverses.
Ensemble de points de vente physiques arborant la même enseigne. Un réseau d'enseigne peut être constitué de points de vente possédés en propre par la structure tête de réseau, prendre la forme d'une franchise ou être composé de points de vente indépendants rassemblés dans le cadre d'un groupement d'achat ou d'approvisionnement.
Somme du résultat d'exploitation et du résultat financier réalisé par une entreprise durant la période d’un exercice comptable. Il ne prend en compte ni le résultat sur produits et charges exceptionnels, ni la participation des salariés aux résultats, ni les impôts sur les bénéfices. Il intègre les charges financières (dont les intérêts sur crédit).
Le résultat courant (ou résultat courant avant impôts) se calcule ainsi : Produits d'exploitation + Produits financiers - Charges d'exploitation - Charges financières = Résultat courant avant impôt.
C'est, sur la période d’un exercice comptable, la différence entre le total du chiffre d’affaires et le total des achats, charges externes, impôts (hors impôt société), salaires, charges sociales et dotations aux amortissements.
Le résultat d’exploitation ne tient pas compte des charges financières, produits et charges exceptionnels, ni de l’impôt société. Cet indicateur exprime la capacité de l'entreprise à générer un bénéfice.
Aux normes internationales le résultat d'exploitation est appelé EBIT (earnings before interest and taxes).
C'est, sur la période d’un exercice comptable, la différence entre le total du chiffre d’affaires et le total des achats, charges externes, impôts, salaires, charges sociales, dotations aux amortissements, charges financières, produits et charges exceptionnels, et impôt société.
Le résultat net négatif s’appelle déficit ou perte. C'est un bénéfice s’il est positif. Dans les sociétés par actions, le résultat net détermine les dividendes pouvant être partagé entre les actionnaires et l'entreprise (réserve).
S
Niveau d'activité minimum à partir duquel une entreprise devient rentable.
C’est le moment à partir duquel les recettes obtenues couvrent l'ensemble des frais (fixes ou variables), aussi appelé point mort ou équilibre.
Au-delà de ce seuil l’entreprise réalise un bénéfice, et en-deçà, une perte.
La valeur de ce seuil est généralement exprimée en chiffre d’affaires encaissé (par jour, mois ou année), ce qui permet de mesurer facilement et régulièrement les performances avec un point de référence lisible (et quotidien pour un commerce, par exemple) et d’y apporter des correctifs éventuels en termes de stratégie générale.
Le compte de résultat intègre les soldes intermédiaires de gestion, détaillant comment l’on aboutit au résultat net de l'exercice comptable.
On peut y constater la marge commerciale, la valeur ajoutée, l’excédent brut d’exploitation, le résultat d'exploitation, le résultat financier (différence entre produits et charges financières), le résultat exceptionnel (différence entre produits et charges exceptionnels).
Le résultat courant avant impôts (RCAI), sur la base duquel on calcule le montant de l'impôt société, donne le montant final, qui est le résultat net. L’on retrouve le résultat net (bénéfice ou perte) au passif du bilan comptable dans les capitaux propres.
Entreprise spécialisée dépendante d'un siège social, mais dotée d'une direction distincte et jouissant d'une relative autonomie, dont la capacité de réaliser des accords commerciaux.
T
Le taux d’usure est le taux d’intérêt maximum (TAEG) que les établissements de crédit peuvent légalement appliquer. Il est révisé à chaque trimestre par la Banque de France. Le TAEG inclut le taux d’intérêt mais aussi les frais divers (de dossier, d’assurance…). Ce taux maximum global sert à protéger les emprunteurs de propositions de crédit excessives.
Les titres de société (appelés parts sociales pour les SARL, EURL et SNC ou actions pour les SA et SAS) sont le titre de propriété sur une entreprise (au travers de son capital).
Dans le cas d’une cession de titres de société, il ne s’agit plus seulement de céder le fonds de commerce, mais toute l’entité juridique (la société) qui l’exploite, avec son actif et son passif.
Ressources financières immédiatement disponibles pour une entreprise, destinées à assurer les dépenses courantes. Véritable nerf de la guerre, la gestion prévisionnelle de la trésorerie permet d’anticiper les décaissements à venir et de prévoir que l'entreprise pourra les assurer.
Plusieurs moyens permettent de gérer au mieux sa trésorerie (négociation des délais de paiement fournisseurs, règlement rapide par les clients et suivi des créances clients, optimisation des stocks, etc.). Elaborer un plan de trésorerie à plusieurs mois permet d’éviter les déconvenues.
V
Différence entre la marge commerciale et les autres achats et charges externes (loyer, énergies, assurances, etc.). Exprime la capacité de l'entreprise à générer du bénéfice à partir de son activité.
La valeur locative est déterminée par le revenu qu'il est possible de retirer de la location d'un bien. Elle prend en compte le loyer au prix réel du marché sur un secteur donné. Cette notion est fondamentale en matière de révision du loyer dans le cadre du renouvellement d'un bail commercial.
- contact@estimermoncommerce.fr
- 41-43 rue de Cronstadt
- 75015 Paris
- Structurer sa base de clients : pourquoi et comment ?
- Owner Buy-Out (OBO) : Définition et enjeux
- Comment valoriser le capital humain de votre commerce ?
- L'impact des cycles économiques sur la valeur de votre commerce
- Comment rédiger une annonce immobilière efficace pour attirer les bons repreneurs ?
- Les ratios financiers : des indicateurs précieux pour votre développement
- Niches fiscales : comment les utiliser pour optimiser votre fiscalité ?
- BIC ou BNC : quel régime fiscal pour mon activité ?
- Bootstrapping : lancer son entreprise avec des fonds minimum
- Guide pratique : le processus de cession de parts sociales
- Pacte Dutreil : définition & conditions de transmission
- Le guide pour mettre en place une levée de fonds
- Qu’est-ce que l’ILC (Indice des Loyers Commerciaux) ?
- Investir votre trésorerie d'entreprise : comment et dans quoi ?
- Qu’est-ce qu’un coup d’accordéon ? Nos explications
- Compte séquestre : de quoi parle-t'on ?
- Que signifie cash-flow ? Définition et calcul
- Taux de profitabilité : explications et calcul
- Gestion de la relation client : principe et conseils
- Budget prévisionnel : conseils pour concrétiser votre projet
- Business angel : définition et avantages
- Crowdfunding : définition, avantages et fonctionnement
- Créer son entreprise sans argent : nos conseils
- Découvrez votre vocation avec la méthode Ikigaï
- Transformation digitale : 8 outils essentiels en entreprise
- Construire une proposition commerciale : conseils
- Conflits au travail : quelles solutions ?
- La clause d’agrément : mode d’emploi
- Quelles sont les aides financières & autres pour la création d'entreprise ?
- Entrepreneuriat : les clefs de la réussite
- Quelles sont les étapes pour créer son entreprise ? Nos conseils
- Franchise : Les avantages pour le franchisé et le franchiseur
- La SARL : avantages et inconvénients
- Le statut SASU : avantages et inconvénients
- Société SAS : avantages & inconvénients
- Bien choisir le statut de son entreprise
- Statut entreprise individuelle : les points à savoir
- Société civile professionnelle : avantages et inconvénients
- Le statut SCI : dans quel cas le choisir ?
- Le statut SNC : dans quel cas le choisir ?
- Le statut EURL : Signification, avantages & inconvénients
- Le pacte d’associés : tout ce qu’il faut savoir
- Comment faire un business model ? Le guide
- Benchmark concurrentiel : nos astuces pour le réussir
- Matrice BCG : Explication, construction et conseils
- La fiscalité d’entreprise : notre guide
- TVA d’entreprise : la taxe sur la valeur ajoutée
- Amortissement du fonds de commerce : notre guide
- Les obligations comptables d’une entreprise
- Le BFR : Guide complet pour évaluer votre entreprise
- Comment lire & comprendre un bilan comptable ? Nos conseils
- L’EBE : Comment bien l’interpréter pour piloter votre entreprise
- Soldes intermédiaires de gestion (SIG) : Le guide
- Quel est le rôle de l’expert-comptable pour une entreprise ?
- Comprendre et établir un compte de résultat
- Tout savoir sur les contrats de travail dans la cession d’entreprise
- Pas-de-porte, droit d’entrée, droit au bail : les différences
- Compte courant d’associé : définition, fonctionnement et cession
- Séquestre fonds de commerce : vente, frais, durée, dispense
- Comment choisir un fonds de commerce de restaurant ? Nos conseils
- Bien choisir son agent immobilier spécialisé en fonds de commerce
- Comment choisir un fonds de commerce de boulangerie ?
- Acte sous seing privé et acte authentique : les différences
- Location-gérance de fonds de commerce : Définition & fonctionnement
- Hotel à vendre : quelles étapes pour un investissement réussi ?
- Nantissement de fonds de commerce : ce qu'il faut savoir
- Maîtriser l'e-reputation de son entreprise
- Entreprise : économiser avec la chasse au gaspillage
- Les méthodes d’optimisation de process en entreprise
- Fixer vos objectifs avec la méthode SMART
- Nos conseils pour bien gérer une entreprise
- Gestion de stock : découvrez nos 8 méthodes
- Elaborer votre tableau de bord d'entreprise
- Comprendre les catégories ERP et leur importance dans l'accessibilité
- Comment se passe la reprise d'une entreprise ? On vous explique
- La clause d'earn out : comprendre son fonctionnement
- Comment faire un business plan ?
- Garantie actif passif : Tout connaître de cette clause
- Leverage Buy-Out (LBO) : définition, intérêt & mise en place
- Cession d’entreprise, reprise et transmission : le guide
- Titres de société : calcul & imposition de la plus-value
- Accompagnement à la création d’entreprise : Le guide
- Gestion de trésorerie en entreprise : Définition & astuces
- Etablir son compte d'exploitation prévisionnel
- Acheter un fonds de commerce : les grandes étapes
- Trouver un local commercial : nos conseils
- En quoi consiste le mécanisme de l'apport cession ?
- Mettre en place la donation avant cession
- Comment valoriser mon entreprise ? Le guide
- Cession de droit au bail : notre mode d'emploi
- Évaluer des titres de société : méthodes & bonnes pratiques
- Formalités d'une cession de fonds de commerce : ce qu'il faut savoir
- Comment estimer la valeur de murs commerciaux ?
- Les différents acteurs d'une cession de fonds de commerce
- Le crédit-vendeur dans une cession de fonds : ses avantages
- La vente d'un fonds de commerce
- Bail commercial : Les points à savoir
- Renouveler un bail commercial : Comment s'y prendre ?
- Calcul et imposition de la plus-value d'un fonds de commerce
- Comment calculer la valeur d'un fonds de commerce ? Le guide
- Compromis de vente de fonds de commerce ou protocole d’accord
- Lettre d’intention d’achat / offre d’achat
- Comment se déroule une cession de fonds de commerce ?
- Qu’est-ce qu’un LBU ? Définition, rôle et spécificités
- Les 7 grandes étapes de l’analyse financière d’une entreprise
- Réussir sa prospection terrain pour constituer un portefeuille de mandats de commerces
- Prospection de commerces à vendre : quelles affaires cibler (ou éviter) ?
- Comment faire une bonne découverte d'un commerce ou d'une entreprise à vendre ?
- Plan de financement pour valider le prix d'une affaire
- Comment monter un dossier de vente d'affaire pro et convaincant ?
- Comment rédiger une bonne annonce de vente de fonds de commerce ?
- Les clés pour bien cerner l'acquéreur d'un commerce
- Les secrets d'une visite d'affaire bien structurée pour transformer
- Comment réduire le temps entre l'offre d'achat et le compromis dans une vente de fonds de commerce ?
- Les secrets du compromis de vente
- Comment aider ton acquéreur à obtenir son prêt professionnel ?
- Comprendre la taxe sur la plus-value d'un fonds de commerce